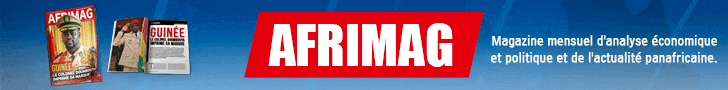Une femme de plus. Une victime de trop. Dans la nuit du 3 avril 2025, à Sambaya, quartier de Kindia, une jeune femme de 22 ans, Oumou Hawa Bah, a été sauvagement battue par son compagnon, après ce qui serait un avortement qu’il n’aurait pas accepté. Le président du conseil de quartier raconte : des cris vers 3h du matin, un silence pesant ensuite, puis des traces de sang découvertes à l’aube. La jeune femme, originaire de Gomba, avait quitté Soliyah pour venir voir son partenaire. Elle a été retrouvée grièvement blessée. Aujourd’hui, elle lutte pour sa vie dans un hôpital régional.
Ce fait, aussi tragique soit-il, n’est pas un cas isolé. Il s’inscrit dans une série macabre qui devient presque routinière en Guinée, comme une sinistre litanie qu’on récite désormais à voix basse, entre deux nouvelles politiques et trois résultats sportifs. On ne compte plus les noms, on les aligne. Le 20 mars, Adama Konaté, commerçante, est tuée par son amant. Une dispute ? Une jalousie ? Un « drame passionnel » comme aiment le dire certains médias pour atténuer l’horreur ? Non. Un féminicide. Un assassinat pur et simple.
Le coup de pied mortel!
Quelques jours plus tard, Oumou Maïga, une épouse comme tant d’autres, succombe aux coups de pied assénés par celui qui, selon la société, devait la protéger. On ne saura peut-être jamais ce qui a déclenché la violence : un reproche ? Un refus de rapport de service ? Une remarque jugée déplacée ? Dans une société où le mari est roi, les femmes n’ont souvent pas le droit d’exister autrement que dans le silence et la soumission.
Puis, le 7 avril, à Sanoyah dans Coyah, c’est Kadiatou Diallo qui meurt étranglée par son mari. Mais cette fois, l’horreur franchit un seuil. Il ne se contente pas de la tuer. Il tente ensuite de faire disparaître son corps en le brûlant dans une fosse, comme on efface une preuve gênante, comme on se débarrasse d’un déchet. Ce n’est plus seulement de la violence. C’est de la barbarie.
Un cancer social
Ces actes ne sont pas isolés. Ils ne tombent pas du ciel. Ils ne sont pas le fruit de malchances individuelles. Ils révèlent un climat, une culture, un cancer social, une tolérance sourde à la violence faite aux femmes. Car à chaque nouveau meurtre, c’est la même routine : un communiqué, quelques photos sur les réseaux sociaux, puis l’oubli. Jusqu’à la prochaine. Et il y aura une prochaine.
Ce n’est plus un simple problème social. C’est devenu une habitude nationale. Une banalité quotidienne. Une chronique de la terreur genrée. Comme si, en Guinée, naître femme était devenu un facteur de risque. Comme si aimer, vivre en couple, ou simplement exister dans un espace dominé par des hommes revenait à signer un potentiel arrêt de mort.
Combien de noms faudra-t-il ajouter à cette liste noire avant que l’on comprenne que le pays est en guerre contre ses propres femmes ? Combien de cadavres faudra-t-il pleurer avant que l’on se décide à regarder cette réalité en face ? Parce que ce n’est pas seulement la violence des hommes qui tue. C’est aussi le silence de la société, l’indifférence des institutions, et l’inaction de ceux qui devraient protéger.
Alors, il faut poser la question qui dérange : qu’ont-elles donc fait, ces femmes guinéennes, pour subir tant de violences ?
Le crime d’exister?
La réponse est brutale : rien. Ou peut-être simplement exister. Aimer. Vouloir choisir. Décider de leur corps. Dire non. Exprimer un désaccord. Refuser un mariage. Avorter. Se plaindre. Se défendre. Bref, vivre. Et cela suffit aujourd’hui à leur valoir les coups, la strangulation, la mort.
Pendant ce temps, la société observe, souvent en silence. On murmure une indignation, on partage un communiqué sur Facebook, on attend la prochaine victime. L’État, lui, répond par l’inaction. Des lois existent, certes. Des textes bien écrits, votés dans des salles climatisées. Mais que valent des lois si elles ne sont ni appliquées, ni connues, ni défendues ? Que valent les ministères concernés si leurs prises de position ne dépassent pas les slogans de conférences ou visite de compassion? Que valent les condamnations officielles si les bourreaux dorment ensuite dans leurs lits, faute de suivi judiciaire, faute de pression populaire, faute de volonté politique ?
Il faut le dire : les violences basées sur le genre en Guinée ne sont pas des faits divers. Ce sont des faits de société. Ce sont les symptômes d’un système profondément patriarcal, dans lequel certaines mentalités considèrent encore la femme comme une propriété. Et tant que cette logique ne sera pas frontalement attaquée, les campagnes de sensibilisation resteront des pansements sur une plaie purulente.
Combattre avec les moyens de bord
Certes, les ONG, les associations féminines, quelques journalistes courageux et des citoyennes engagées se battent au quotidien. Mais elles sont seules, ou presque. Elles crient dans un désert d’indifférence générale. Elles portent sur leurs épaules le poids d’un combat que l’État lui-même devrait assumer. On attend d’elles qu’elles fassent le travail de la justice, de la police, des institutions. Et quand une femme meurt, on leur demande encore de faire le deuil à notre place.
Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas de dénoncer uniquement les auteurs directs de ces violences. Il s’agit de dénoncer aussi ceux qui les couvrent, ceux qui les excusent, ceux qui les banalisent. Chaque proverbe machiste toléré, chaque sermon religieux mal interprété, chaque pression familiale pour « sauver le mariage » au prix de la dignité d’une femme, chaque silence complice : tout cela participe de cette spirale de violences.
Au nom de la « dignité « ?
Ce n’est pas un problème privé. C’est un scandale public. Une crise nationale. Et tant que l’on considérera ces meurtres comme des affaires de couple, tant que l’on continuera de dire aux femmes de « supporter », de « garder leur foyer », de « ne pas salir le nom de la famille », les cercueils continueront de se fermer, un à un, sur nos sœurs, nos filles, nos mères, nos collègues.
Il est temps de briser le silence. De sortir du déni. D’exiger des enquêtes sérieuses, des procès, des condamnations exemplaires. D’imposer que chaque commissariat prenne au sérieux les plaintes des femmes. D’imposer que les autorités locales, les leaders religieux, les familles et les éducateurs prennent clairement position contre cette barbarie.
Le sang d’Oumou Hawa Bah n’est pas un détail. Il est un signal. Un de plus. Et peut-être le dernier avant l’irréparable.
La Guinée ne pourra pas se dire démocratique, civilisée, en paix, tant qu’elle continuera d’enterrer ses femmes pour avoir osé vivre.
Aly KOMANO