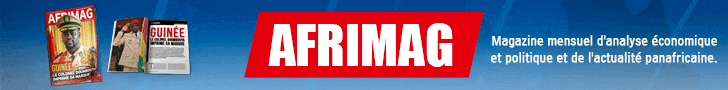Le vent de rupture souffle fort à Niamey. Le 26 mars dernier, la junte militaire au pouvoir a tourné une page symbolique de l’histoire postcoloniale du Niger : le français, langue du colonisateur, ne figure plus comme langue officielle du pays.
C’est un véritable coup de tonnerre linguistique et politique. Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a promulgué une nouvelle « Charte de la refondation » faisant office de Constitution. Dans son article 12, la charte redéfinit la politique linguistique du pays : le français est rétrogradé au rang de langue de travail, au même titre que l’anglais.
Désormais, la langue nationale du Niger est le haoussa, tandis que neuf autres langues, parmi lesquelles le zarma-songhay, le fulfuldé (peul), le kanouri, le gourmantché ou encore l’arabe, sont reconnues comme les principales langues parlées du pays.
Cette décision intervient quelques mois seulement après l’annonce fracassante du retrait du Niger de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), un geste fort qui s’inscrit dans une série de prises de distance avec l’influence française en Afrique de l’Ouest.
Derrière ce changement linguistique se joue un profond mouvement de souveraineté. En bousculant l’héritage colonial jusque dans la langue, les autorités nigériennes entendent réaffirmer une identité culturelle propre, ancrée dans les réalités linguistiques du peuple nigérien. Un acte politique fort, qui fera sans doute école dans une région où la Francophonie est de plus en plus contestée.
Laguinee.info