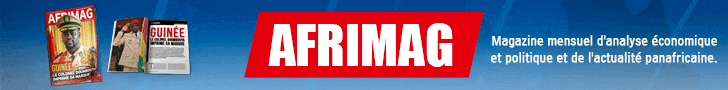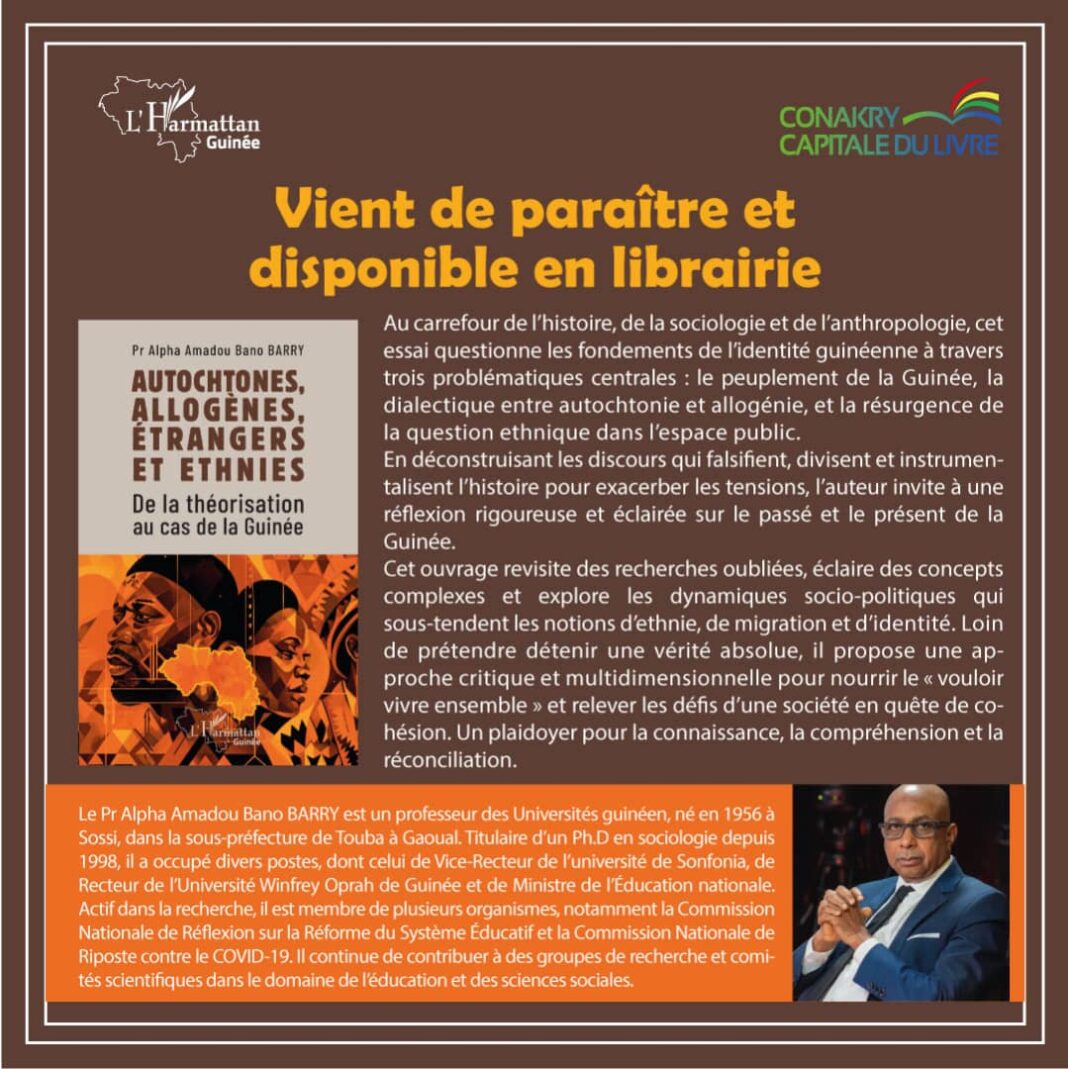Comment la Guinée a-t-elle été peuplée ? Que recouvrent véritablement les notions d’autochtone, d’allogène ou d’étranger dans l’imaginaire collectif guinéen ? Pourquoi la question ethnique est-elle devenue si pesante dans le débat public ? Autant de problématiques brûlantes qu’aborde le professeur Alpha Amadou Bano Barry dans son nouvel essai, « Autochtones, Allogènes, Étrangers et Ethnie », un ouvrage rigoureux, fouillé, et éminemment salutaire à l’heure où la société guinéenne vacille entre mémoires sélectives, discours claniques et quête désespérée de cohésion.
Né en 1956 à Sossi, dans la sous-préfecture de Touba, préfecture de Gaoual, l’auteur n’en est pas à son premier chantier intellectuel. Titulaire d’un Ph.D en sociologie, ancien Vice-recteur, ex-ministre de l’Éducation nationale, enseignant-chercheur engagé dans plusieurs commissions scientifiques, le Pr Barry revient avec une plume aussi acérée qu’érudite pour interroger ce que nous croyons savoir de nous-mêmes.
En publiant l’ouvrage « Autochtones, Allogènes, Étrangers et Ethnie », le professeur Alpha Amadou Bano Barry, sociologue de formation, professeur d’université, ancien ministre de l’Éducation nationale, déploie une analyse lucide et rigoureuse sur les racines du peuplement guinéen, les constructions sociales autour de l’ethnie et les mécanismes contemporains de polarisation identitaire.
Trois parties, une seule ambition : démystifier l’ethnie
Le professeur Barry retrace dans son livre une fresque fascinante des mouvements humains ayant façonné la Guinée. Loin des récits figés, l’ouvrage montre que les identités sont le produit de migrations multiples, de brassages, de refoulements parfois violents.
Cet essai dense de 162 pages, articulé autour de trois grandes parties, pose une question fondamentale : comment penser l’identité guinéenne à l’épreuve de son histoire migratoire, de ses dynamiques sociopolitiques et de ses fractures ethniques ?
L’ouvrage s’organise en trois grandes parties. La première, méthodique, s’attaque au processus de mise en place des populations guinéennes. À travers une enquête croisée entre traditions orales, sources historiques et hypothèses migratoires, Bano Barry déconstruit les récits simplistes sur les origines ethniques. L’historique du peuplement devient ici un exercice aussi nécessaire que complexe
La deuxième partie de l’ouvrage se penche sur les origines des groupes en Guinée et tente de répondre à cette question cruciale : d’où viennent les populations guinéennes ? À cette interrogation, l’auteur oppose une réponse nuancée : « L’histoire du peuplement de la Guinée est un chantier inachevé où les légendes se mêlent aux faits, et où l’identité se construit souvent à l’encontre de l’Autre. »
Dans la troisième partie, sans doute la plus contemporaine, Bano Barry aborde la résurgence de la question ethnique dans l’espace public. Ici, le sociologue s’inquiète : l’ethnie devient de plus en plus.
La Guinée, une terre de brassage ancien
Le Pr Barry commence par démonter une vision figée du peuplement de la Guinée. « Faire l’historique du peuplement de la République de Guinée est un exercice à la fois simple et complexe », écrit-il. Simple, car les archives existent ; complexe, car elles sont souvent incomplètes, biaisées ou transformées en légendes. « Il est simple, car il est toujours possible de répéter les nombreux écrits réalisés sur certaines des populations de ce pays. […] Il est complexe, car il existe peu de documentation sur certaines populations guinéennes », écrit l’auteur.
Ainsi, si des groupes comme les Baga, Soussou, Peul, ou Malinké ont bénéficié d’une certaine attention scientifique, d’autres comme les Mikhiforé, les Lélé, ou les minorités de la forêt demeurent encore peu étudiés.
Ainsi, les Mandenyi, présentés comme les premiers habitants de la zone côtière de la Guinée selon Zainoul A. Sanoussi, auraient migré du Foutah Djallon vers la région forestière avant de rejoindre les côtes atlantiques « Forécariah a été habité par une population de souche Mandeyi dont le pays d’origine serait aux confins de Macenta et de Guéckédou », rapporte le professeur.
La présence des Temné remonterait à une période très ancienne, et qui ont laissé leur empreinte jusque dans le toponyme du quartier Teminetaye à Kaloum, « la ville des Teméné en soussou ». Aujourd’hui quasi absents du paysage ethnique guinéen, ils auraient pourtant précédé les Mandenyi dans certaines zones de l’actuelle préfecture de Forécariah. Ils seraient issus du bassin du Sénégal et auraient évolué dans le Foutah Djallon avant de rejoindre la côte.
À ces migrations s’ajoutent celles des Nalou, des Dialonké, des Soussou, ou encore des Peul du Wassoulou, chaque groupe étant arrivé par différentes routes : via le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Ghana ou encore le Niger, selon les études mobilisées.
C’est ici que se déploie le talent de sociologue de l’auteur, lorsqu’il éclaire les tensions entre les groupes comme les Baga, les Soussou, les Peuls ou les Malinké. Il explique, par exemple, que les Baga, les Landouma et les Nalou auraient occupé autrefois les plateaux du Nord du Foutah Djallon « Il semble qu’avant d’arriver le long du littoral, les Baga, les Landouma et les Nalou ont aussi transité par la région du Foutah Djallon », écrit Barry, avant d’être refoulés vers le littoral par les Dialonke, eux-mêmes ensuite déplacés par les Peuls musulmans au XVIIIe siècle.
Ethnie : entre mythe biologique et construction politique
Dans sa deuxième partie, le professeur Bano Barry remet en question la nature même du concept d’ethnie. Est-ce un fait biologique ou une construction sociale ? L’auteur tranche : « l’ethnie est une construction historique, sociale et politique, toujours mouvante et réinterprétée ». Il invite à revisiter les catégories figées, souvent imposées par les administrations coloniales.
Dans ce jeu de mouvements et de conflits, les ethnies guinéennes apparaissent moins comme des blocs homogènes que comme les produits d’histoires croisées, de migrations, d’alliances et de dominations.
La question ethnique dans l’espace public : une résurrection dangereuse
La troisième partie du livre est sans doute la plus engagée. Le professeur Barry y dénonce la manipulation politique des appartenances ethniques : « L’ethnie n’est pas la cause, mais le prétexte. Elle devient un instrument de l’accès au pouvoir, de sa conservation ou de sa contestation » : « L’enjeu a toujours joué un rôle essentiel dans l’accès et l’exercice du pouvoir, hier comme aujourd’hui », avertit-il.
Il démonte au passage l’idée que l’ethnie serait une donnée « naturelle » ou biologique. Pour lui, il s’agit bien d’une construction sociale, souvent renforcée par l’État, les partis politiques et les discours populistes.
Il explore la façon dont les leaders politiques instrumentalisent l’appartenance communautaire, créant une illusion d’évidence entre ethnie et loyauté politique. « Dans les discours publics, l’ethnie devient un totem ou un tabou selon les stratégies électorales du moment », analyse-t-il. En le faisant, ils se font « manipuler » eux-mêmes par le fait ethnique, tel un « larron qui se fait voler ». C’est lorsqu’ils quittent/perdent le pouvoir qu’ils se rendent compte d’avoir été dupé par la question ethnique.
Le livre appelle à une rupture avec cette logique de division. Il plaide pour une société guinéenne fondée sur la mémoire partagée, la reconnaissance des parcours historiques et l’inclusion de toutes les composantes dans le projet national.
Une contribution scientifique majeure
« Autochtones, Allogènes, Étrangers et Ethnie » est un ouvrage indispensable pour qui veut comprendre les racines profondes des fractures identitaires en Guinée. C’est aussi un appel à la connaissance, à la réconciliation et à la responsabilité collective en faisant parler l’histoire pour apaiser le présent. Un livre qui nous rappelle que pour bâtir l’avenir, il faut d’abord décortiquer lucidement le passé.
Ce nouvel essai s’inscrit dans la continuité de ses engagements : promouvoir une pensée critique et une déconstruction des faux-semblants identitaires. Une œuvre au carrefour de la sociologie, de l’histoire et de la mémoire. Ce livre est tout sauf un manuel figé. Il est un plaidoyer vivant pour la connaissance, la compréhension mutuelle et la réconciliation. En revisitant des sources oubliées, en interrogeant les récits dominants, et en proposant des alternatives interprétatives, Bano Barry pose les bases d’un nouveau pacte national. Loin de prétendre détenir une vérité absolue, il propose une approche critique et multidimensionnelle pour nourrir le « vouloir vivre ensemble », lit-on dans la conclusion.
Un message d’autant plus nécessaire dans un pays où les appartenances ethniques sont trop souvent convoquées pour opposer, exclure ou dominer. Ce livre nous invite à penser la Guinée non comme un patchwork d’ethnies figées, mais comme une nation en construction où les identités sont plurielles, mouvantes, et enracinées dans une histoire commune souvent mal connue.
C’est une œuvre de référence pour chercheurs, décideurs et citoyens. « Autochtones, Allogènes, Étrangers et Ethnie » s’impose donc comme une œuvre de référence. Que l’on soit chercheur, étudiant, décideur public ou simple citoyen curieux, cet essai propose des clés essentielles pour mieux comprendre les racines des tensions identitaires actuelles et les moyens d’en sortir.
En offrant une lecture « désidéologisée » et « dé-ethniciser » de l’histoire guinéenne, Bano Barry fait œuvre utile. Et au moment où la société guinéenne est plus que jamais traversée par des crispations identitaires, il est bon de s’arrêter pour lire, réfléchir, et peut-être, se concilier avec notre passé commun.
La rédaction de Laguinee.info