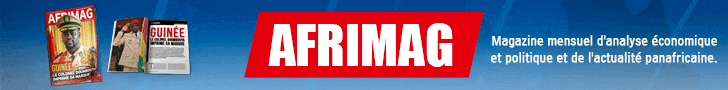Il fut un temps où la CEDEAO imposait le respect. Lorsqu’elle prenait une décision, les États membres s’exécutaient, conscients qu’ils avaient affaire à une institution qui savait faire respecter ses principes. Mais aujourd’hui, le constat est implacable : la CEDEAO n’est plus que l’ombre d’elle-même. Fragilisée par les putschs successifs en Afrique de l’Ouest, divisée entre ses membres, incapable de faire appliquer ses propres résolutions, elle se débat dans une crise existentielle qui menace sa survie.
Une autorité en lambeaux face aux coups d’État
La déchéance de la CEDEAO a pris une tournure brutale avec la vague de coups d’État qui a secoué la région ces dernières années. D’abord le Mali en 2020, puis la Guinée en 2021, le Burkina Faso en 2022, et enfin le Niger en 2023. À chaque putsch, l’organisation a condamné, sanctionné, menacé. Mais à chaque fois, elle s’est heurtée à des juntes résolues à tenir tête, et surtout à une incapacité totale d’appliquer ses propres décisions.
Le cas du Niger est emblématique. Lorsqu’Abdourahamane Tiani a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023, la CEDEAO a immédiatement haussé le ton. Elle a promis une intervention militaire si la junte ne rétablissait pas l’ordre constitutionnel. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois. Et au final, l’organisation a reculé, incapable de passer à l’acte, faute d’un consensus entre ses membres et face à la détermination des putschistes.
En refusant de donner suite à ses propres menaces, la CEDEAO a perdu toute crédibilité. Elle a envoyé un message clair aux autres États : ses lignes rouges ne sont qu’illusions, ses résolutions ne sont que du vent.
Des chefs d’État incapables de parler d’une seule voix
Pourquoi la CEDEAO s’est-elle montrée aussi impuissante ? La réponse est simple : elle est minée par les divisions internes de ses membres.
D’un côté, la France poussait à une intervention musclée au Niger, tandis que les États-Unis prônaient une approche plus diplomatique. Entre ces deux lignes contradictoires, les chefs d’État africains eux-mêmes étaient incapables de s’entendre. Certains, comme le président nigérian Bola Tinubu, voulaient une réponse ferme, mais d’autres, comme le Togo ou le Sénégal, freinaient des quatre fers.
Cette cacophonie a conduit à une paralysie totale. Incapable de trancher entre répression et conciliation, la CEDEAO a opté pour le pire des choix : l’inaction. Et c’est ainsi que la junte nigérienne, comme celles du Mali et du Burkina Faso avant elle, a pu s’installer dans la durée sans craindre de représailles sérieuses.
L’humiliation en série : la CEDEAO réduite à mendier
Loin de reprendre l’initiative, la CEDEAO enchaîne désormais les humiliations. La plus récente est venue de Guinée-Bissau, où le président Umaro Sissoco Embaló – pourtant un ancien président en exercice de l’institution – a tout simplement expulsé ses émissaires. La raison ? Ils ne respectaient pas la feuille de route fixée par son gouvernement.
Ce camouflet symbolise la descente aux enfers de l’organisation. Autrefois, un État membre n’aurait jamais osé traiter la CEDEAO avec autant de désinvolture. Aujourd’hui, elle est à ce point discréditée qu’un président en exercice peut la défier sans la moindre conséquence.
Pire encore, elle se retrouve désormais dans la posture inverse : au lieu d’exclure ceux qui violent ses principes, c’est elle qui court derrière eux. Le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, a entrepris une tournée auprès des pays frondeurs du Sahel – Mali, Burkina Faso et Niger – pour tenter de les convaincre de revenir dans le giron de la CEDEAO. Mais que peut-il leur offrir, sinon une façade institutionnelle qui n’impressionne plus personne ?
Une organisation piégée par sa propre faiblesse
Tibou Kamara l’affirme sans détour : « la CEDEAO ne pourra se relever que si elle cesse de se plier aux caprices des uns et des autres », dit-il à JeuneAfrique.com
Le problème, c’est que cette soumission aux volontés de chacun est devenue la norme au sein de l’organisation. Plutôt que d’affirmer une position claire et ferme, elle oscille entre compromissions et hésitations. Elle a perdu le sens de sa mission première : garantir la stabilité et la démocratie en Afrique de l’Ouest.
L’ultime paradoxe, c’est qu’en cherchant à ménager tout le monde, la CEDEAO s’est vidée de sa substance. Elle voulait être le pilier de l’intégration régionale, elle est devenue un simple club de chefs d’État sans pouvoir. Elle voulait être un arbitre impartial, elle est devenue un figurant dont plus personne ne respecte les décisions.
Un avenir plus qu’incertain
La CEDEAO peut-elle encore se relever ? Rien n’est moins sûr. Elle aurait pu rebondir en se montrant intransigeante sur ses principes, en sanctionnant avec rigueur les dérives autoritaires, en défendant sans faille ses textes. Mais elle a préféré la complaisance, la navigation à vue et les volte-face.
Aujourd’hui, elle n’a plus de moyens de pression, plus de crédibilité, et même plus d’unité entre ses membres. Ce qu’il reste d’elle, ce sont des symboles et des sigles, mais plus aucune force réelle.
Si rien ne change, elle risque de devenir une coquille vide, un souvenir d’une époque révolue où elle pouvait encore imposer le respect. L’Afrique de l’Ouest n’attend plus grand-chose d’elle. Et c’est bien là le drame.
Laguinee.info